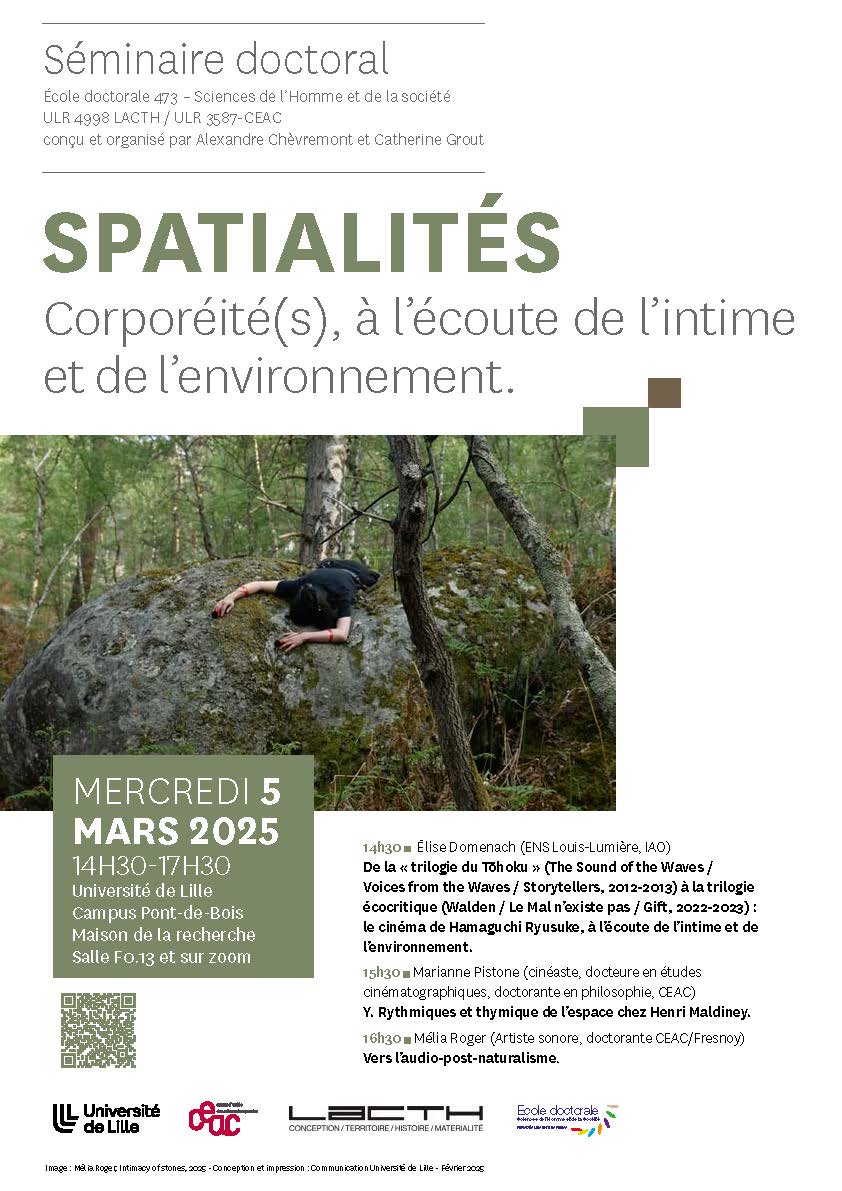Organisation et conception : Alexandre CHEVREMONT (CEAC) et Catherine GROUT (LACTH)
Date : Mercredi 5 mars 2025, 14h30 – 17h30
Lieu : Salle F0.13, Maison de la Recherche, Campus Pont-de-Bois, Université de Lille
Lien Zoom : https://univ-lille-fr.zoom.us/j/97731941874?pwd=Hz7D7IzhQzHfq6rCb82Z3PQDweqcK0.1
Programme :
- 14h30 – Elise DOMENACH (ENS Louis-Lumière, IAO)
De la « trilogie du Tohoku » (The Sound of the Waves / Voices from the Waves / Storytellers, 2012-2013) à la trilogie écocritique (Walden / Le Mal n’existe pas / Gift, 2022-2023) : le cinéma de Hamaguchi Ryusuke, à l’écoute de l’intime et de l’environnement.
- 15h30 – Marianne PISTONE (cinéaste, docteure en études cinématographiques, doctorante en philosophie, CEAC)
Y. Rythmiques et thymique de l’espace chez Henri Maldiney.
- 16h30 – Mélia ROGER (Artiste sonore, doctorante CEAC / Fresnoy)
Vers l’audio-post-naturalisme.
Site du CEAC : CEAC
Séminaire doctoral transversal CEAC & LACTH
Spatialités – Corporéité(s), à l’écoute de l’intime et de l’environnement.
Élise Domenach (ENS Louis-Lumière, IAO)
« De la « trilogie du Tōhoku » (The Sound of the Waves / Voices from the Waves / Storytellers, 2012-2013) à la trilogie écocritique (Walden / Le Mal n’existe pas / Gift, 2022-2023) : le cinéma de Hamaguchi Ryusuke, à l’écoute de l’intime et de l’environnement. »
La fiction récente de Hamaguchi Ryusuke, Le Mal n’existe pas (2023) a, dans certains médias, été considérée comme une « fable écologique », un film à thèse écologiste, qui semblait profondément nouveau pour l’auteur de drames urbains moraux (Drive My Car, Asako 1&2, Happy Hour). Notre lecture visera à inscrire ce film dans le contexte d’une trilogie qu’il a consacrée à l’héritage du transcendantalisme américain : Walden (court film expérimental, 2022), Le Mal n’existe pas et Gift (film silencieux, destiné à accompagner les performances musicales live de Eiko Ishibashi, compositrice multi-instrumentiste), et dans la continuité de la « trilogie du Tōhoku » qu’il a réalisée avec Kō Sakai dix ans plus tôt, en mettant en scène des entretiens menés avec des rescapés de la triple catastrophe de Fukushima. Nous nous mettrons à l’écoute d’un fil inaperçu dans l’œuvre de Hamaguchi Ryusuke : son intérêt continu pour la mise en place d’espaces d’« écoute et de parole » au sein du film et par les moyens de la mise en scène, et son intérêt pour l’élaboration de réponses filmiques à notre « scepticisme environnemental » qui impliquent d’imaginer des dispositifs de tournage ou de montage qui créent des espaces pour la reconnaissance de ce trait fondamental de nos vies avec les autres et le monde.
Marianne Pistone (cinéaste, docteure en Arts du spectacle, doctorante en philosophie, CEAC)
« Y. Rythmiques et thymique de l’espace chez Henri Maldiney »
Mais dans ce premier moment le y ou le da désigne un lieu naturel qui n’est pas encore une agora où l’on se comprend. […] C’est quelque chose comme le Ah ! de celui qui revient à soi en « revenant au monde ». Ce premier moment de la présence, de l’être à…, possède le mode thymique et climatique, d’ailleurs voilé, de la confiance et de l’angoisse.
« Y être », pour le philosophe phénoménologue Henri Maldiney (1912-2013), c’est être dans l’ouvert, dans la présence, une présence conçue comme précédent la conscience. « Y être » et « il y a » se pensent dans le sentir, un sentir antérieur à la perception même. C’est dans l’espace pictural crucialement que ce y nous advient, via une notion centrale dans la philosophie de Maldiney : le rythme.
Bien plus qu’une orientation dans l’espace géographique, le rythme est un repérage existentiel. Cette spatialité existentielle est toute différence de la spatialité objective. C’est que l’espace du corps propre ne se limite pas à son enveloppe ni même à l’immédiatement préhensible, mais que je suis d’ores et déjà à tout l’espace, dans une contraction et expansion (la dialectique systole/diastole) active qui ménage les tensions proche/lointain, ici/là-bas, sol/ciel. Repensant l’espace comme champ d’attente et, comme tel, tensif, Maldiney, tout au long de son œuvre, va scander ce y comme un cri, le « ah ! » de l’étonnement, l’étonnement sans cesse renouvelé – et dont la peinture est la déclaration – devant le miracle de l’apparaître, celui précisément du « il y a ».
Comment élucider ce y français (à l’instar du da allemand), vis à vis du « ici » de la topographie, du « là » de l’ontologie ? Maldiney postule : sans doute comme le pivot de la compréhension du monde, ou comme la dramatique de l’existence.
A travers ses œuvres principales, consacrées à la peinture et à la notion d’ « espace du paysage », mais aussi dans des textes plus rares (notamment la correspondance avec Roland Kuhn) je me propose de chercher quelques explicitations de ce y, au risque in fine de buter contre son insolubilité, puisque comme le dit lui-même Maldiney : « Que nomme ce « y » ? Son sens ne perce jamais aussi expressément que lorsqu’il se dérobe. »
Mélia Roger (Artiste sonore, doctorante CEAC/Fresnoy)
« Vers l’audio-post-naturalisme »
Comment penser les pratiques audio-naturalistes dans un contexte de crise écologique? Une des postures du ‘field recordist’ dépeint souvent une personne à l’écoute d’une Nature dont il ne ferait pas partie, cherchant à rester silencieux, invisible, à rendre également son matériel d’enregistrement transparent. Et si nous cherchions à écouter cet entre-deux habituellement inaudible entre l’oreille et le micro, en pensant notre présence dans le paysage ? Nous écouterons des rencontres entre ‘le field’ et le ‘recording’, le moment où le micro devient support et activateur du champ sonore. Puis, à travers un extrait de l’installation audiovisuelle « Tendre Phonocène » (2024, Le Fresnoy – studio national des arts contemporains) nous tâcherons d’imaginer une manière poétique de prendre soin des paysages par l’enrichissement acoustique.